Invasion des Sargasses : Foire aux Questions (FAQ)
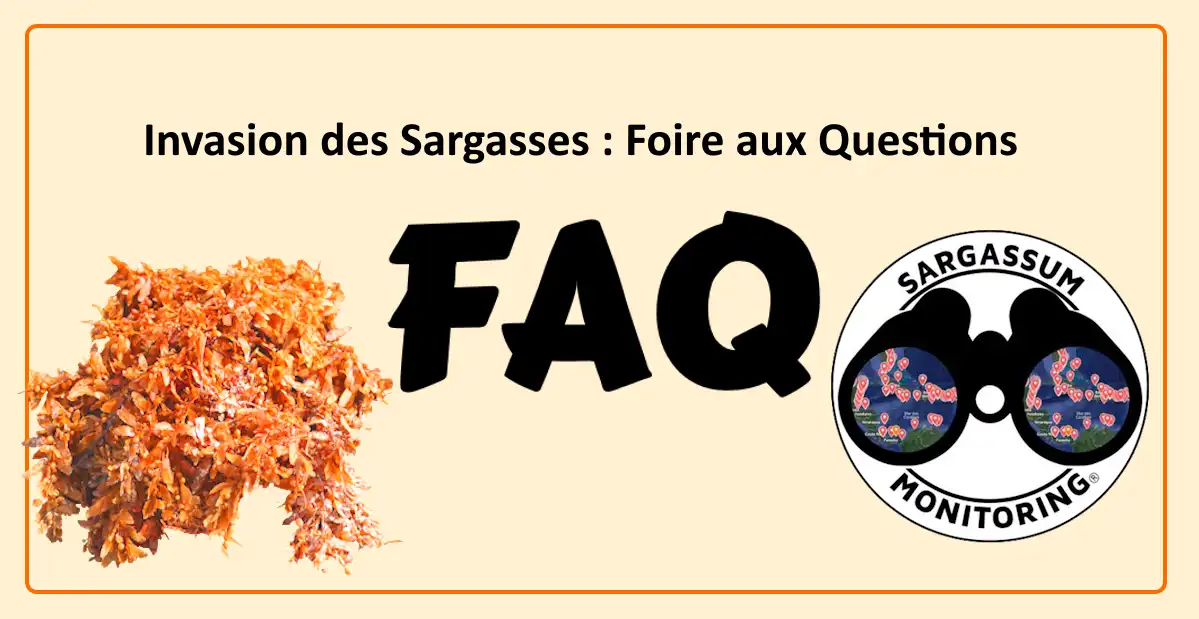
What is Sargassum ?
Les sargasses sont des algues brunes marines de la famille des Sargassaceae. Contrairement à la majorité des algues fixées sur les fonds marins, certaines espèces, comme Sargassum fluitans et Sargassum natans flottent librement à la surface de l'océan, formant de vastes radeaux. Contrairement aux algues benthiques qui sont accrochées au fond de l’eau, on les appelle algues pélagiques.
En mer, les radeaux de sargasses constituent des habitats pour de nombreuses espèces marines, offrant des zones de reproduction et de protection pour les poissons, les tortues et d'autres organismes. Cependant, une fois échouées en grande quantité sur les plages, elles peuvent perturber les écosystèmes côtiers et nécessitent une gestion appropriée.
Parmi les nombreuses espèces de sargasses, trois sont principalement responsables des échouages massifs observés ces dernières années :
• Sargassum fluitans
• Sargassum natans I
• Sargassum natans VIII
Les trois formes de sargasses sont responsables des échouages massifs observés ces dernières années sur les côtes de la mer des Caraïbes et de l'Atlantique.
Pour plus de détails consultez notre website : Sargassum Monitoring.
Les sargasses, macro algues brunes flottantes, sont historiquement associées à la mer des Sargasses, une région de l'Atlantique Nord où elles forment des radeaux naturels servant d'habitat à diverses espèces marines. Cependant, depuis 2011, une nouvelle zone de prolifération, distincte de la mer des Sargasses, est apparue : la "Grande Ceinture de Sargasses de l'Atlantique" (Great Atlantic Sargassum Belt). Cette ceinture s'étend sur environ 8 850 kilomètres, de l'Afrique de l'Ouest au golfe du Mexique, et représente la plus vaste étendue d'algues brunes jamais observée.
La formation de cette nouvelle ceinture est attribuée à des modifications des conditions océaniques et climatiques. Les sargasses, autrefois principalement confinées à la mer des Sargasses, se développent désormais dans des zones situées au large de l'embouchure de l'Amazone, dans l'océan Atlantique. Poussées par les courants marins dominants, elles dérivent vers les côtes des Antilles, de la Guyane et d'autres régions de la mer des Caraïbes, provoquant des échouages massifs aux conséquences écologiques et économiques significatives.
Ainsi, bien que les sargasses soient originellement liées à la mer des Sargasses, la prolifération observée depuis 2011 provient principalement de cette nouvelle ceinture atlantique, résultant de changements environnementaux récents.
Les chercheurs évaluent encore diverses hypothèses sur la cause de ce premier événement extrême documenté. L’une d’entre elles propose que pendant l’hiver 2009-2010, les vents qui soufflent généralement vers l’est, des Amériques vers l’Europe, se soient renforcés et déplacés vers le sud de manière plus spectaculaire et plus persistante que n’importe quelle autre période située entre 1900-2020. Ce changement de vent a déclenché une dispersion à longue distance vers l’est des sargasses, de la mer des Sargasses vers la péninsule ibérique en Europe et en Afrique de l’Ouest. Après avoir quitté la mer des Sargasses, les sargasses ont dérivé vers le sud dans le courant des Canaries et sont entrées dans les tropiques. Une fois dans ce nouvel habitat tropical atlantique favorable, avec beaucoup de soleil, des eaux chaudes et une disponibilité en nutriments, les sargasses ont prospéré et ont continué à croître.
Outre les changements de régime des vents, d’autres hypothèses incluent une combinaison de facteurs, tels que la variation du débit des principaux fleuves (par exemple l’Amazone et l’Orénoque), la concentration en nutriments (azote et phosphore) dans les océans, l’augmentation de la quantité de phosphore due à la poussière saharienne, la température de l’eau et le ruissellement des rivières.
Ayant établi une nouvelle population, les algues sargasses s’agglutinent désormais presque chaque année, à partir de janvier/février, dans un énorme andain ou « ceinture » au nord de l’équateur, le long de la région où convergent les alizés. À la fin de l’hiver et au début du printemps, les algues sargasses se déplacent vers le nord au gré des vents et des courants saisonniers. En juin, cette ceinture pourrait s’étendre sur tout l’Atlantique tropical central. De grandes portions de ces algues sont ensuite transportées dans la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique via les systèmes de courants nord-équatoriaux et caribéens.
Depuis 2011, de vastes accumulations de sargasses se produisent chaque année dans la mer des Caraïbes, le golfe du Mexique et l'Atlantique tropical. La quantité de ces algues brunes varie d'une année à l'autre, mais la tendance générale indique une augmentation significative par rapport à la période précédant 2011. Ces sargasses s'étendent sur environ 5 000 kilomètres, de l'Atlantique tropical oriental jusqu'à la côte mexicaine dans la mer des Caraïbes. Elles flottent en plaques de tailles diverses, allant de quelques centimètres à plusieurs centaines de mètres. Certaines de ces plaques atteignent les zones côtières, affectant plages, ports et systèmes de pompage d’eau de mer.
Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer cette recrudescence :
• Changements climatiques : Les modifications des courants marins et des températures de l'eau pourraient favoriser la prolifération des sargasses.
• Apports nutritifs accrus : Les nutriments apportés par de grands fleuves comme l'Amazone, ainsi que les particules issues des feux de forêt en Afrique, pourraient enrichir les eaux et stimuler la croissance des sargasses.
Des programmes de recherche sont en cours pour mieux comprendre ces phénomènes et améliorer la prédiction des échouages futurs. La complexité des courants, l'étendue de la zone concernée et les données disponibles à ce jour ne permettent pas encore de prédire l'évolution de ce phénomène récent sur le long terme.
Les études de l’impact des sargasses sur la santé humaine ont commencé très récemment, et ce sujet nécessite encore du temps pour être pleinement compris. Cependant, il est déjà établi que leur décomposition entraîne l’émission de gaz tels que l’hydrogène sulfuré (H₂S) et l’ammoniac (NH₃). L’H₂S, reconnaissable à son odeur d’œuf pourri, peut provoquer des irritations des yeux et des voies respiratoires, des maux de tête, des vertiges, voire des nausées, notamment chez les personnes sensibles.
Une étude menée par le Centre hospitalier universitaire de Martinique a révélé que les femmes enceintes vivant à proximité des échouements de sargasses présentent un risque accru de prééclampsie, une complication de la grossesse caractérisée par une hypertension artérielle et la présence de protéines dans les urines.
De plus, les sargasses contiennent souvent des métaux lourds, tels que l’arsenic et le cadmium, qui peuvent être toxiques pour les humains et les animaux. L’accumulation de ces substances dans l’environnement soulève des préoccupations quant à leur impact à long terme sur la santé et les écosystèmes.
Impact sur l'environnement : lorsqu’elles s’accumulent sur les côtes, elles peuvent étouffer les coraux, les herbiers marins ainsi que la faune sous-marine et recouvrir les plages, contribuant à la détérioration des écosystèmes côtiers. Une fois échouées, leur décomposition attire aussi de nombreuses mouches et autres insectes.
Impact économique : La décomposition des sargasses produit du sulfure d'hydrogène, dont l'odeur nauséabonde décourage les baigneurs et nuit au tourisme, un secteur clé dans les régions touchées. Les coûts de nettoyage sont élevés pour les hôtels et les municipalités, et l'image des destinations balnéaires en pâtit à long terme.
Elles peuvent aussi perturber la navigation, obstruer l’arrivée d’eau dans les usines et, en cas d’enfoncement au fond de l’océan il y aurait un risque d’affecter durablement les écosystèmes benthiques.
Face à ces multiples impacts, une gestion efficace des échouages est essentielle pour limiter les conséquences sur la santé publique, la biodiversité et les activités économiques.
Il est préconisé de privilégier la récolte des sargasses en mer, à proximité du littoral, avant leur échouage sur les plages. Cette approche permet de limiter les impacts environnementaux et sanitaires associés aux échouages massifs. Lorsque la collecte en mer est impossible, le ramassage sur les plages devient nécessaire. Toutefois, il est déconseillé d'utiliser des engins lourds pour cette tâche car ils peuvent prélever une quantité significative de sable (environ 50%), aggravant ainsi l'érosion côtière. Les techniques de collecte adaptées doivent être mises en place pour éviter au maximum les prélèvements de sable et réduire les impacts sur la végétation de haut de plage.
Les travailleurs impliqués dans la collecte de sargasses doivent être protégés en raison des risques d'exposition aux gaz toxiques libérés par les algues en décomposition. Les mesures préventives comprennent le port d' équipements de protection individuelle (EPI), recevoir une formation sur la détection des gaz toxiques, et la surveillance régulière des concentrations de gaz sur les sites de collecte.
Certaines autorités locales mettent en place des actions telles que le ramassage régulier des algues échouées, l'installation de barrages flottants pour limiter leur arrivée sur les plages, et le suivi des concentrations de gaz émis. Les efforts de recherche sont également en cours pour mieux comprendre le phénomène et développer des solutions durables.
Oui, plusieurs initiatives visent à valoriser les sargasses échouées. Cependant, il est important de considérer plusieurs défis avant de lancer une entreprise de recyclage :
• Irrégularité des arrivages : Les échouages de sargasses varient en fréquence et en volume selon les saisons et les années, rendant l'approvisionnement en matière première incertain.
• Spécificités locales : Chaque île ou pays touché par les sargasses possède ses propres contraintes environnementales, économiques et réglementaires. Il est essentiel d'adapter les solutions de valorisation aux réalités locales.
• Présence de métaux lourds : Les sargasses ont la capacité d'accumuler des métaux lourds, notamment l'arsenic et le cadmium, ce qui peut poser des risques pour la santé humaine et l'environnement. Cette contamination limite certaines utilisations, comme l'alimentation humaine ou animale, et nécessite des précautions lors de la valorisation.
Malgré ces défis, des projets innovants sont en cours :
• Production de biogaz : Des recherches explorent la transformation des sargasses en biogaz, offrant une source d'énergie renouvelable. La production de biogaz à partir des sargasses est une piste prometteuse pour valoriser ces algues envahissantes. Des recherches ont exploré la transformation des sargasses en biogaz, offrant une source d'énergie renouvelable. Cependant, la disponibilité irrégulière des sargasses peut poser des défis pour une production continue de biogaz. Pour pallier cette variabilité, les hôtels et autres établissements peuvent envisager de mélanger les sargasses avec des déchets végétaux et alimentaires. Cette approche permettrait de stabiliser l'approvisionnement en matière organique pour la méthanisation, tout en contribuant à une gestion plus durable des déchets. Ainsi, en intégrant les sargasses aux biodéchets, il est possible de produire du biogaz de manière plus régulière, tout en réduisant l'impact environnemental des déchets organiques.
• Fabrication de bioplastiques : Certaines entreprises développent des procédés pour transformer les sargasses en bioplastiques biodégradables.
• Valorisation des sargasses en compost et engrais, opportunités et défis : L'utilisation des sargasses en compost ou en engrais nécessite une attention particulière en raison de leur forte teneur en sel et de la présence de métaux lourds tels que l'arsenic et le cadmium, ce qui constitue un risque pour la fertilité des sols et la sécurité alimentaire. Le sel agit comme un désherbant naturel, ce qui peut nuire à la croissance des plantes. Par conséquent, un rinçage à l'eau douce est essentiel pour les rendre utilisables. Cependant, sur les îles, l'eau douce est une ressource précieuse dont la gestion est complexe. Autrefois, les Antillais collectaient les sargasses en petites quantités et les suspendaient aux branches des arbres pour que la pluie les rince naturellement avant de les utiliser comme engrais, principalement pour les arbres fruitiers. Cette méthode permettait de réduire leur salinité de manière efficace. Toutefois, les volumes de sargasses étaient alors bien moindres que les tonnes qui s'échouent aujourd'hui sur les côtes depuis 2011, ce qui complique l'application des techniques traditionnelles de traitement et de valorisation. À Porto Rico, leur utilisation en agriculture et en compost a été interdite en raison de la contamination des sols. Pour éviter ces problèmes, certaines entreprises ont mis en place des procédés visant à transformer les sargasses en engrais biologique. Ces initiatives offrent une alternative aux fertilisants chimiques, mais nécessitent des protocoles stricts pour garantir l'absence de résidus toxiques. L'objectif est de transformer un problème environnemental en opportunité économique et écologique, tout en minimisant les risques pour l'environnement et la santé humaine.
• Briques de sargasses : une solution viable ? La fabrication de briques à partir de sargasses est une idée innovante pour valoriser ces algues envahissantes. En les mélangeant avec de l'argile, il est possible de créer des matériaux de construction écologiques. Cependant, les sargasses contiennent une quantité importante de sel. Ce sel peut poser des problèmes, car il peut attirer l'humidité, ce qui pourrait affecter la durabilité et la résistance des briques. De plus, la présence de sel peut entraîner la corrosion des armatures métalliques utilisées dans les structures construites avec ces briques. Pour atténuer ces effets, il est nécessaire de rincer les sargasses à l'eau douce afin d'éliminer le sel avant de les utiliser dans la fabrication des briques. Cependant, dans de nombreuses régions insulaires, l'eau douce est une ressource précieuse, et son utilisation pour ce processus peut ne pas être viable. De plus, la fabrication de ces briques nécessite une source d'argile à proximité. Si l'argile doit être transportée sur de longues distances, cela peut augmenter les coûts et l'empreinte carbone du processus, réduisant ainsi les avantages environnementaux potentiels de cette approche. En conclusion, bien que la fabrication de briques à partir de sargasses soit une solution prometteuse pour valoriser ces algues, il est essentiel de considérer les défis liés à la teneur en sel des sargasses et à la disponibilité de l'argile. Des recherches supplémentaires et des analyses de faisabilité sont nécessaires pour déterminer si cette méthode peut être mise en œuvre de manière durable et rentable.
Les chercheurs utilisent l’imagerie satellite pour repérer les zones en haute mer où la densité de sargasses est élevée et estimer les zones côtières les plus susceptibles d’être touchées. Bien que ces observations ne constituent pas une prévision exacte, elles permettent aux communautés de mieux se préparer aux échouages massifs.
Pour affiner ces estimations, les scientifiques analysent les courants océaniques, les vents et les conditions de vagues qui influencent la trajectoire des sargasses. Cependant, identifier ces algues depuis l’espace reste un défi, car cela repose sur la manière dont la lumière se réfléchit à la surface de l’océan
Des recherches sont en cours, menées par diverses organisations, afin d’améliorer la précision des modèles de prévision et de mieux comprendre l’impact des phénomènes océaniques sur la distribution des sargasses.
Le phénomène des sargasses présente une certaine saisonnalité, bien que celle-ci puisse varier en fonction des régions et des conditions climatiques. Traditionnellement, les échouages massifs de sargasses sur les plages des Caraïbes et du golfe du Mexique se produisent principalement entre avril et août, pendant les mois les plus chauds. Cependant, ces dernières années, des arrivages ont été observés tout au long de l'année, rendant la prévision des échouages plus complexe.
Par exemple, en 2023, les sargasses sont arrivées de manière précoce sur certaines plages mexicaines. Cette variabilité souligne l'importance de la surveillance continue et de l'adaptation des stratégies de gestion pour faire face à ce phénomène en constante évolution. Les cartes des arrivages de Sargassum Monitoring, alimentées par les contributions de la science citoyenne, montrent désormais des échouages tout au long de l'année.
La science citoyenne joue un rôle crucial dans la compréhension et la gestion du phénomène des sargasses. En impliquant les citoyens dans la collecte de données et le suivi des échouages, elle permet de :
• Améliorer la surveillance : Les observations locales fournies par les résidents complètent les données scientifiques, offrant une vision plus précise et en temps réel des zones affectées.
• Sensibiliser les communautés : Les données recueillies par les citoyens constituent une ressource précieuse pour les chercheurs, aidant à identifier des tendances et à développer des stratégies de gestion adaptées. Les initiatives telles que le réseau mondial de science citoyenne sur les sargasses (Sargassum Monitoring) encouragent cette collaboration entre scientifiques et citoyens, contribuant à une gestion plus efficace et inclusive du phénomène.
• Faciliter la recherche : Les données recueillies par les citoyens constituent une ressource précieuse pour les chercheurs, aidant à identifier des tendances et à développer des stratégies de gestion adaptées.
• Améliorer et étalonner les outils de prévision : Grâce aux photos et observations fournies par les citoyens, les chercheurs peuvent vérifier et affiner leurs modèles de prévision des échouages. Ces données permettent d’identifier les tendances, d’adapter les algorithmes aux conditions locales et d’accroître la précision des prédictions, offrant ainsi des alertes plus fiables aux communautés impactées.
La prévision de l'évolution des échouages de sargasses est complexe en raison de la variabilité des facteurs environnementaux impliqués. Les observations récentes indiquent une tendance à l'augmentation des échouages massifs depuis le début des années 2010. Cette hausse est attribuée à divers facteurs, notamment les changements climatiques, les modifications des courants marins et l'enrichissement des eaux en nutriments.
Des initiatives de recherche visent à améliorer la compréhension des proliférations de sargasses et à développer des modèles de prévision à court et long terme. Ces efforts sont essentiels pour anticiper les échouages et mettre en place des stratégies de gestion adaptées.
En dépit des efforts de recherche, l'évolution future des échouages de sargasses reste incertaine. Il est donc crucial de continuer à surveiller le phénomène et de développer des stratégies de gestion flexibles pour s'adapter aux variations potentielles.
Pour connaître les zones et les périodes touchées par les échouages de sargasses, vous peuvez consulter les cartes interactives disponibles sur le site Sargassum Monitoring Depuis 2018, le site propose des cartes annuelles des arrivages de sargasses, enrichies par des photos et vidéos datées et géolocalisées, fournies par des citoyens engagés. Ces cartes offrent une mémoire visuelle des échouages, permettant de se renseigner sur l'évolution du phénomène dans les 43 pays de la Caraïbe et au-delà.
Ces ressources uniques sont précieuses pour planifier des voyages en tenant compte des zones potentiellement affectées par les sargasses.
Se baigner dans des zones envahies par les sargasses est déconseillé pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la décomposition de ces algues libère des gaz, notamment de l'hydrogène sulfuré, qui peuvent être nocifs pour la santé. De plus, la présence massive de sargasses peut entraîner des désagréments physiques, comme des irritations cutanées, et rendre la baignade désagréable. Il est donc recommandé d'éviter les plages touchées par les sargasses et de privilégier celles qui en sont épargnées ou protégées.
Promener votre animal de compagnie dans des zones envahies par les sargasses est déconseillé. La décomposition de ces algues libère des gaz tels que le sulfure d'hydrogène (H₂S), qui peuvent être nocifs pour la santé humaine et animale. De plus, les sargasses en décomposition dégagent une odeur nauséabonde, rendant la promenade désagréable pour vous et votre animal. Il est donc préférable d'éviter les zones touchées par les sargasses pour assurer la sécurité et le bien-être de votre compagnon.
• Participer à la science citoyenne : Signalez les échouages de sargasses en envoyant vos photos directement à Sargassum Monitoring ou en les partageants sur leur groupes Facebook.
• Réduire la pollution : Limitez l'utilisation d'engrais chimiques et évitez les rejets polluants dans les cours d'eau pour diminuer les nutriments favorisant la prolifération des sargasses.
• Soutenir Sargassum Monitoring en faisant un don pour aider au développement d'outils de détection et à la diffusion d'informations sur les sargasses.
• Participer aux efforts de nettoyage : Rejoignez des initiatives locales de ramassage des sargasses sur les plages, en respectant les consignes de sécurité pour éviter l'exposition aux gaz toxiques émis par les algues en décomposition.
• Sensibiliser votre entourage : Informez votre communauté sur les impacts des sargasses et encouragez des pratiques respectueuses de l'environnement.
Ces actions vous permettent de contribuer activement à la gestion des sargasses et à la protection de l'environnement.
Actuellement, en 2025, 43 pays et îles reçoivent des arrivées massives de sargasses.
• Anguilla
• Antigua et Barbuda
• Aruba
• Les Bahamas
• La Barbade
• Belize
• Les Bermudes
• Bonaire
• Brésil
• Îles Vierges britanniques (BVI)
• Îles Canaries (Espagne)
• Îles Caïmans
• Colombie
• Côte d'Ivoire (Afrique)
• Cuba
• Curaçao
• Dominique
République Dominicaine
• Îles françaises : Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Marie-Galante
• La Gambie (Afrique)
• Ghana (Afrique)
• Grenade
• La Guyane
• Haïti
• Honduras
• Jamaïque
• Libéria
• Mauritanie
• Mexique
• Montserrat
• Panama
• Portugal et Madère
• Porto Rico (USA)
• Saint-Christophe et Niévès
• Sainte-Lucie
• Saint-Vincent et les Grenadines
• Sénégal (Afrique)
• Sint Maarten
• Trinité-et-Tobago
• Îles Turques-et-Caïques
• États-Unis (USA)
• Îles Vierges américaines (USVI)
• Venezuela
Pour aller plus loin
• Consultez régulièrement sargassummonitoring.com/fr pour des cartes, les alertes et les prévisions.
• Rejoignez le mouvement Sargassum Monitoring pour contribuer activement à la surveillance et à la gestion des sargasses, et ensemble, protégeons nos océans.
IMPORTANT:
La science et la gestion des sargasses évoluent constamment, entraînant des mises à jour régulières de notre Foire aux Questions (FAQ). En tant qu'organisation indépendante, Sargassum Monitoring s'engage à fournir des informations fiables et à jour sur ce phénomène complexe. Nous vous encourageons à consulter régulièrement notre FAQ pour rester informé des dernières avancées et des réponses actualisées à vos questions.
